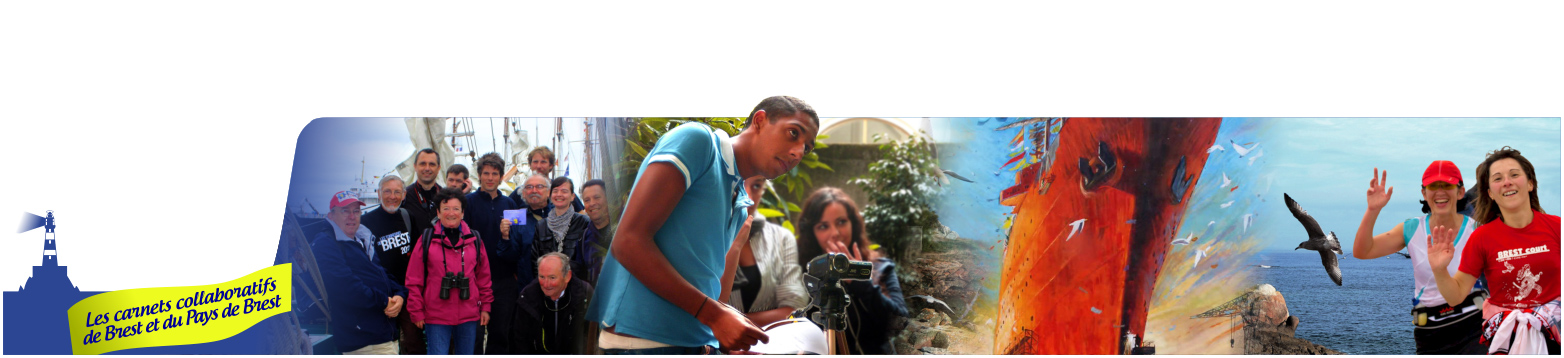Mai 68 à Brest : Différence entre versions
(Page créée avec « '''Cet article est la version intégrale, publiée ici sur l'initiative de l'auteur, d'un dossier paru dans l'hebdomadaire ''Côté Brest'' en mai 2018.''' Si l’on n’... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 10 septembre 2018 à 12:09
Cet article est la version intégrale, publiée ici sur l'initiative de l'auteur, d'un dossier paru dans l'hebdomadaire Côté Brest en mai 2018.
Si l’on n’en retient généralement que le versant parisien, le mouvement de mai 68 n’en fut pas moins d’ampleur nationale et concerna toutes les régions de France, y compris la Bretagne. On s’en doute, les événements de Brest n’eurent aucune commune mesure avec ceux de Nantes où l’on a même parlé d’une « commune » nantaise [1] et encore moins avec ceux de Paris, mais la ville du Ponant n’est pas restée sourde pour autant à l’appel des pavés. Tout d’abord, quel était son visage à la veille de ce mois de mai entré dans la légende ?
Sommaire
Brest en 1968 : état des lieux
Urbanisme
Le Brestois d’aujourd’hui qui aurait l’opportunité de voyager dans le temps et de remonter cinquante ans en arrière aurait sans doute la surprise de ne pas être complètement dépaysé. Certes, on était encore loin de l’avènement du nouveau tramway et du téléphérique urbain mais Brest n’était déjà plus la ville en ruines héritée de la guerre donnant « des envies d’ailleurs »[2] que quitta sans remords Jean-Michel Caradec. Entre 1965 et 1967, le premier grand ensemble était sorti de terre sur le plateau du Bouguen et, en 1968, le quartier de Kerourien voyait le jour. Ainsi, une nouvelle agglomération voyait le jour sur les ruines d’une cité bombardée : si l’enthousiasme pour « Brest la blanche » a fait long feu, l’élévation des HLM n’en représenta pas moins un progrès phénoménal pour ceux qui avaient connu l’habitat en baraques, comme en témoigna l’un des premiers habitants de Kerourien : « On a retrouvé ici des connaissances du Polygone, des gens qui, comme nous, avaient vécu dans les baraques en bois. Entrer en HLM, c’était comme une promotion sociale : de la surface, des chambres pour les enfants, c’était autre chose ! »[3]
Université et enseignement supérieur
L’Université de Bretagne Occidentale n’existait pas encore mais la vie étudiante s’enracinait : pour faire face à un nombre d’étudiants sans cesse grandissant, les facultés rennaises avaient ouvert des collèges universitaires à Brest, celui de sciences (CSU) en 1959 et celui de lettres (CLU) en 1960. L’école d’ingénieur avait fait son apparition en 1961, celle de commerce en 1962, celle de médecine en 1966, l’institut de droit en 1967 (qui accueillit aussitôt 404 étudiants pour 250 prévus !) et un premier département d’IUT en 1968. Les graines de l’UBO étaient donc semées et germaient déjà : de 1960 à 1968, les CSU et CLU de Brest passèrent de 554 à 3354 étudiants. Détail important, en 1966, 80 % d’entre eux étaient boursiers, 42 % étaient issus de familles d’agriculteurs, d’ouvriers et d’employés contre un quart seulement au niveau national. Mais tout n’était pas parfait : ces nouveaux lieux de formation manquaient d’enseignants, le CSU ne pouvait préparer à la maîtrise de sciences naturelles, il n’y avait pas de cours de philosophie ni de préparation au CAPES. Et surtout, la tutelle de Rennes était pesante : les professeurs, qui enseignaient aussi bien à Brest qu’à Rennes, étaient régulièrement absents et l’université rennaise monopolisait les crédits. Autant dire que quand les étudiants brestois battront le pavé deux ans plus tard, ils ne ressembleront pas aux « fils de bourgeois qui faisaient la révolution »[4] pour reprendre l’expression par laquelle le dessinateur Reiser désignait les étudiants parisiens.
Industrialisation et démographie
Les difficultés des étudiants brestois illustraient celles de la ville toute entière : en raison notamment de son Arsenal, Brest restait une ville de forte tradition ouvrière où la nouvelle façade moderne n’atténuait pas le sentiment d’abandon généralisé qui dominait alors la Basse-Bretagne et n’épargnait pas la ville. Malgré la mise en place, à la fin des années 1950, des liaisons régulières à l’aéroport de Guipavas, puis l’installation de la CSF (Compagnie générale de télégraphie sans fil, future Thalès) et des téléphones Ericsson, la conviction d’être les oubliés du progrès et de l’industrialisation dominait les Bretons qui étaient nombreux à quitter la région pour trouver du travail. Si Brest, avec un excédent migratoire « moyen » était moins concernée que Rennes et Vannes, il n’empêche que son taux d’accroissement naturel était en baisse, passant de 3,2 % à 2 % entre 1962 et 1968 : à la veille des événements de mai, elle comptait 160.000 habitants, la croissance de la population avait été moins rapide que pour le reste de la France. En somme, Brest offrait, pour reprendre les termes d’Edmond Monange, le visage d’une « ville pauvre » qui n’a pas profité de « la vague des Trente glorieuses » et « souffrait d’une insuffisance de consommation »[5].
Politique
Les « miettes » de progrès que recueillait Brest devaient beaucoup à la ténacité du maire de l’époque, Georges Lombard, membre éminent du Celib (Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons) plus soucieux de lutter pour sa ville que de plaire à l’État central : homme de droite, il n’hésitait cependant pas à braver le pouvoir gaullien qui ne voyait d’avenir à Brest que dans les activités liées à la défense[6]. Son côté frondeur lui valut notamment, dans cette terre bretonne fidèle au général De Gaulle, de perdre son siège de député en 1962, ravi par le gaulliste Charles Le Goasguen, pour mieux le reconquérir cinq ans plus tard. Brest ne dépareillait donc pas outre mesure dans une région alors ancrée à droite mais il n’empêche qu’en matière de fronde, l’exemple venait d’en haut.
Voilà donc le Brest de 1968 : une ville étudiante en devenir, ouvrière par tradition, encore ancrée à droite mais déjà digne de sa réputation d’« insoumise » et dominée par un sentiment d’abandon commun à toute la région. On pourrait donc dire que tous les ingrédients étaient réunis pour qu’elle soit emportée par le mouvement de mai, mais ce serait encore en-dessous de la vérité : loin d’avoir été une simple courroie de transmission du mouvement parisien, Brest l’a précédé !
Le journal des événements brestois
Les prémices
15 février : Un mois avant le fameux 22 mars qui a marqué l’histoire de la Sorbonne, 200 à 300 étudiantes occupent la cité des garçons du Bouguen pendant une heure. Les étudiants leur emboîteront pas deux jours plus tard en occupant la cité des filles. Dans la même période, l’UNEF organise de nombreuses AG pour dénoncer le caractère obsolète de l’enseignement magistral.
19 février : Les étudiants demandant à être reconnus comme des adultes obtiennent satisfaction avec le vote d’un nouveau règlement intérieur garantissant la fin de la ségrégation sexuelle, la liberté d’expression, l’autodiscipline et l’octroi aux étudiants de la responsabilité de l’animation culturelle. Mars-avril : Débrayages en série à la brasserie de Kérinou et à l’usine CSF. La tension monte en Bretagne, les syndicats ouvriers et paysans appellent à une journée régionale d’action le 8 mai – cette date n’était pas fériée à l’époque.
9 mars : Création du CABRO (Comité d’Action pour la Bretagne de l’Ouest) qui élabore un programme de sauvetage économique de la Bretagne portant notamment sur la mise en place d’un complexe portuaire Brest-Douarnenez.
28 mars : Dans l’amphithéâtre du CSU, Meeting d’étudiants et d’enseignants décidant de soutenir la journée du 8 mai. Un constat sévère de la situation du CLU et de son environnement y est dressé. 27 avril : Les électriciens de bord des chantiers de l’Arsenal, employés de sociétés sous-traitantes de la marine, entament une grève qui va durer plus d’un mois.
L'embrasement
7 mai : Au cours d’un meeting organisé en réaction aux événements parisiens, l’AGEB (Association Générale des Étudiants de Brest)[7] appelle à la grève illimitée.
8 mai : Journée régionale d’action. Selon Vincent Porhel, « des renforts de CRS sont envoyés de Paris vers la Bretagne »[8]. Un mot d’ordre : « L’ouest veut vivre ». À elle seule et malgré la pluie, Brest mobilise un tiers des manifestants de la région : Georges Lombard lui-même soutient la grève et bat le pavé avec ses administrés, quelques membres du clergé manifestent aussi par solidarité. Sur les 6.600 personnes employées par l’Arsenal, 6.300 sont en grève et représentent 95% des grévistes. En tout, 90% des travailleurs brestois, tous secteurs confondus (public, privé et nationalisé), font la grève, soit 10.000 manifestants selon les forces de l’ordre et 25.000 selon la presse régionale qui dénombre également 400 étudiants : l’un d’eux, Bernard Broudic, président de l’AGEB, s’exprime le premier, avant les ouvriers et les paysans, et défend le droit des étudiants brestois à vivre et à travailler au pays dans un discours très applaudi. Les commerçants baissent tous le rideau en signe de solidarité à l’exception d‘un certain Édouard Leclerc… Le journal Ouest France précisera qu’on n’avait jamais vu autant de manifestants à Brest : de fait, le cortège faisait 2 kilomètres de long et était le plus important de tout le Finistère ! Les syndicats doivent s’opposer physiquement à des jeunes qui souhaitaient investir la permanence du parti gaulliste et le centre Leclerc.
9 mai : À l’appel de l’AGEB et du SNESUP, la grève des étudiants de sciences et de lettres et des enseignants est effective. 2.500 étudiants brestois vont déposer une motion à la sous-préfecture.
10 mai : Mise en place d’un service d’ordre étudiant.
11 mai : Meeting devant le Restaurant Universitaire. Le CSU est occupé, les comités de grève universitaire se fondent en un intercomité. Des étudiants occupent la sonorisation de la quinzaine commerciale et profitent du réseau de haut-parleur pour lire leur tract établi avec l’ensemble des syndicats, ce qui est leur première action sortant de la stricte légalité. Le mouvement étudiant brestois se distingue néanmoins par son calme : « Pas de barricades, pas un seul graffiti sur les murs de la fac ! »[9] On est loin des « enragés » parisiens…
13 mai : Grève générale et manifestation nationale : aux revendications sociales s’ajoute la demande du départ du général De Gaulle. À Brest, les ouvriers et les étudiants manifestent ensemble. Le CLU est occupé. Le Télégramme, en grève également, ne donnera les chiffres que deux jours plus tard : 12.000 manifestants le matin et 15.000 l’après-midi, dont la moitié sont des grévistes de l’Arsenal. La police réduit ces chiffres à 7.000.
16 mai : Mise en place de la commission paritaire qui instaure une cogestion à la tête du mouvement universitaire. Le report des examens est voté.
17 mai : Les cours reprennent temporairement en sciences et à l’école d’ingénieur. La SNCF entre en grève illimitée : dans la nuit, la gare et le dépôt de la machine sont occupés.
18 mai : En prévision d’une négociation sur les prix agricoles fixée à Bruxelles pour le 27 mai, la FNSEA appelle à une journée nationale « d’avertissement » prévue le 24.
19 mai : Les ouvriers de la CSF de Brest rédigent un cahier de revendications dans lequel apparait le concept d’autogestion qui n’aura jamais d’application concrète.
20 mai : Après trois jours de préparation, la CFDT déclenche l’occupation de l’usine CSF qui va durer un mois et donner le coup d’envoi de la généralisation de la grève dans la ville : une entreprise de bâtiment et quatre usines métallurgiques sont également occupées. Les capésiens boycottent les examens.
21 mai : L’Arsenal vote la grève à 76,8%, entraînant dans son sillage les entreprises sous-traitantes. 8168 travailleurs débrayent mais l’AG rejette l’idée d’une occupation, au grand soulagement de la marine. Les élèves du lycée technique voient l’armée, qui craint l’expansion, débarquer dans leur cour[10]. Le port de commerce est paralysé et les navires déviés. On dénombre 15.000 grévistes à Brest.
22 mai : Les chantiers de l’Île longue s’arrêtent.
23 mai : Les grévistes de la CSF reçoivent quatre étudiants brestois.
24 mai : Journée nationale « d’avertissement ». La participation est nettement inférieure à celle 13 mai : 5.000 manifestants à Brest selon la presse, 4.000 selon la police. Des commissions ouvrières sont créées : la CFDT reconnaît aux étudiant le mérite d’avoir « ouvert la brèche ». Les difficultés d’approvisionnement devenant critiques, le conseil municipal votre à l’unanimité une subvention de 100.000 francs pour nourrir les enfants des grévistes : 900 repas sont servis dans quatre cantines scolaires.
25 mai : 2.200 repas sont servis dans neuf cantines scolaires. La commission paritaire s’autoproclame Conseil de Faculté, la « Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Brest » proclame unilatéralement son autonomie – sa création ne sera officialisée qu’en juillet. Quelques étudiants tentent de prendre d’assaut la sous-préfecture, le service d’ordre de la CGT doit s’y opposer physiquement.
26 mai : Création d’un comité de solidarité intersyndical recevant des dons et des produits agricoles.
27 mai : Trois jours après l’annonce d’un referendum par le général De Gaulle, nouvelles manifestations : on dénombre 15.000 personnes dans les rues de Brest selon Ouest France, 8.000 selon la police. Des agriculteurs distribuent du lait et des pommes de terre aux grévistes brestois. Le Centre d’Étude Socialiste de Brest organise un débat sur « le mouvement étudiant en France et en Europe ».
30 mai : Les travailleurs de l’Arsenal entérinent un accord à main levée. Après l’allocution radiophonique du général De Gaulle, un comité d’action civique se met en place à Brest. Au Relecq-Kerhuon, le comité de grève fait servir des repas à la cantine sur présentation de la carte de gréviste.
31 mai : La place Général-Leclerc est rebaptisée place du peuple, une action purement symbolique qui n’est symptomatique d’aucun débordement, la situation brestoise étant restée globalement peu violente. Le premier ministre Georges Pompidou reçoit une délégation bretonne, comprenant Georges Lombard, qui espère faire bénéficier la région d’un nouveau plan de développement économique.
Le reflux
1er juin : Les soutiens au général De Gaulle font descendre plus de 3.000 personnes dans les rues : en tête de ce cortège, Michel Cotton de Bennetot. Les « gaullistes » croisent régulièrement le cortège des contestataires sans aucun affrontement.
4 juin : Le ministre des armées, Pierre Messmer, ratifie l’accord accepté par les grévistes de l’Arsenal cinq jours auparavant : ceux-ci valident à bulletin secret la reprise du travail à 72%.
5 juin : Les ESU (Étudiants Socialistes Unifiés)[11] organisent un débat sur le thème « Mai 68, révolution manquée, révolution trahie ? » avec le soutien du comité de soutien au mouvement du 22 mars.
7 juin : Reprise du travail dans le bâtiment. Six usines sont encore en grève, dont trois sont occupées.
8-11 juin : Reprise progressive du travail chez les dockers, les employés communaux et les métallurgistes. L’usine CSF de Brest est la dernière usine du Finistère à rester en grève.
13 juin : Début des négociations avec la direction locale de la CSF.
15 juin : Une délégation brestoise se rend aux assises nationales des Lettres à Clermont-Ferrand.
18 juin : 594 grévistes de la CSF contre 98 se prononcent pour la poursuite de la grève. La direction a tenté de faire voter 253 « jaunes » pour la reprise.
21 juin : Les négociations aboutissement finalement sur l’obtention d’une « commission » consultative spécialisée » dans le cadre du comité d’établissement. La reprise est finalement acceptée par 511 voix contre 152. La CSF de Brest est la dernière entreprise de Bretagne à reprendre le travail !
30 juin : Second tour des élections législatives. Le gaulliste Michel de Bennetot l’emporte dans une triangulaire contre Georges Lombard et un candidat communiste. On note toutefois, fait exceptionnel en Bretagne et même en France, une légère progression d’une force de gauche, la FGDS (Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste) : les partis de gauche ont pâti de leur dispersion
Un bilan ?
La suite appartient à l’histoire : pour Brest, elle s’est notamment traduite par le processus qui déboucha en 1971 sur la création de l’UBO qui dotait la ville d’une structure universitaire autonome et répondait partiellement aux revendications des étudiants brestois en les libérant de la tutelle rennaise.
Quant au referendum du 27 avril 1969 qui entraîna la démission du général De Gaulle, comme le fit remarquer Georges Lombard, « les Brestois ont voté contrairement au reste de la France »[12] mais conformément au reste de la Bretagne, c’est-à-dire majoritairement pour le « oui » : rien que sur les 82 communes de l’arrondissement de Brest, deux seulement ont donné la majorité au « non » ! Mais les résultats n’en furent pas moins révélateurs d’un relatif effritement du soutien de Brest au chef de l’État : premièrement, sur 83.990 électeurs inscrits, 63.925 « seulement » se sont déplacés, soit 23,76 % d’abstention, un chiffre très élevé pour l’époque. Deuxièmement, le « oui » n’avait « que » 2.175 voix d’avance sur le « non » et avait donc recueilli 51,73 % des suffrages exprimés à Brest, on était loin des 69 % de « oui » dans la même ville au referendum de 1962 et des 60 % de votes favorables à De Gaulle aux présidentielles de 1965. Pour la petite histoire, durant la campagne référendaire, les deux camps ont pu compter sur des soutiens surprenants : Édouard Leclerc fit ouvertement campagne pour le « oui » tandis que le « non » reçut l’appui de Jacques Médecin, alors député-maire de Nice, qui vint défendre son point de vue à Brest le 20 avril.
On ne peut pas parler du mai 68 brestois comme d’une simple version light du mai parisien. Si le mouvement a été nettement moins violent, il n’a pas été moins durable pour autant : les étudiants de Brest avaient même une longueur d’avance sur ceux de la Sorbonne et les ouvriers, notamment à la CSF, ont été fidèles à la réputation de ténacité des Bretons. Mais surtout, même si les événements parisiens ont certainement joué un rôle de déclencheur et même d’accélérateur, les Brestois ont avant tout exprimé leur mécontentement face à des problèmes concrets et spécifiques à leur ville. Loin d’être les « fils de bourgeois qui s’encanaillent » caricaturés par les détracteurs du mouvement, les étudiants étaient majoritairement des enfants des milieux populaires qui réclamaient de meilleures conditions pour étudier et, à terme, grimper dans l’échelle sociale. De même, loin d’être tous des « rouges » ou des « révolutionnaires », les ouvriers voulaient avant tout profiter eux aussi de la prospérité de la France des « trente glorieuses » et ne plus se sentir délaissés en raison du décentrement de leur région. Le mouvement brestois avait donc une spécificité régionale qui nous interdit de l’envisager uniquement à travers le prisme du « modèle » parisien, ce qui pourrait suffire à expliquer pourquoi il fut assez peu violent et ne prit jamais un tour véritablement révolutionnaire.
- ↑ « Un Comité central de grève (CCG) s’est installé à la mairie de Nantes au soir du 24 mai. Son action est-elle comparable à celle de la commune de 1871 ? S’agit-il d’un soviet sur les bords de la Loire ou d’un embryon de pouvoir ouvrier ? (…) Avec le recul et en resituant ce qui se passe à Nantes dans le contexte régional et national, il est permis d’en douter, mais un véritable mythe s’est cristallisé. » Christian BOUGEARD, Les années 68 en Bretagne, PUR, Rennes, 2017, p. 138. La plupart des renseignements ayant servi à écrire cet article sont tirés de l’ouvrage de Christian Bougeard.
- ↑ Rémi DE KERSAUSON, « Jean-Michel Caradec, mémoire retrouvée d’un poète musicien », Cahiers de l’Iroise n°227, SEBL, Brest, 2017, p. 12.
- ↑ D’une rue à l’autre… Couleur quartier, édité par les habitants de Kerourien-Keranroux, Brest, 2003, p.42.
- ↑ « On m’a toujours pris pour un gauchiste, mais je n’ai rien fait en 68. Strictement rien. Je suis allé une fois à la Sorbonne et ça m’a choqué, ces fils de bourgeois qui faisaient la révolution. Tout de suite j’ai pensé que ça ne pouvait pas marcher. » Cf. Reiser à la une, Glénat, Paris, 2008, p. 96.
- ↑ Roger FALIGOT, Brest l’insoumise, Dialogues, Brest, 2016, p. 657.
- ↑ Trois ans avant sa mort, Georges Lombard déclara à Mikaël Cabon que durant son mandat, le ministre des Armées lui avait tenu ce langage : « Mais il n’y a pas d’avenir pour Brest, pas d’arrivée d’industrie à espérer. On n’aurait jamais dû construire cette ville, et garder les ruines pour en faire un musée. » Cf. Op.cit., p.656. Cette citation est-elle authentique ? Et quand bien même, reflète-t-elle vraiment le regard de l’État concernant Brest ? On peut raisonnablement en douter, rien n’interdit de penser que, comme beaucoup d’hommes politiques, Georges Lombard, sentant la mort approcher, ait pris le parti d’enjoliver sa propre légende.
- ↑ Présentes dans chaque ville universitaire, les AGE étaient les antennes locales de l’UNEF.
- ↑ Vincent PORHEL, Mai 68 au CLU de Brest, mémoire de maîtrise consultable au Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Brest, 1988, p.6.
- ↑ Roger FALIGOT, Brest l’insoumise, p.656.
- ↑ Témoignage d’un élève de l’époque.
- ↑ Organisation de jeunesse du PSU (Parti Socialiste Unifié), les ESU dirigeaient le bureau national de l’UNEF depuis janvier 1967 et le congrès national de Lyon.
- ↑ Déclaration reprise dans Le Télégramme du 28 avril 1969.