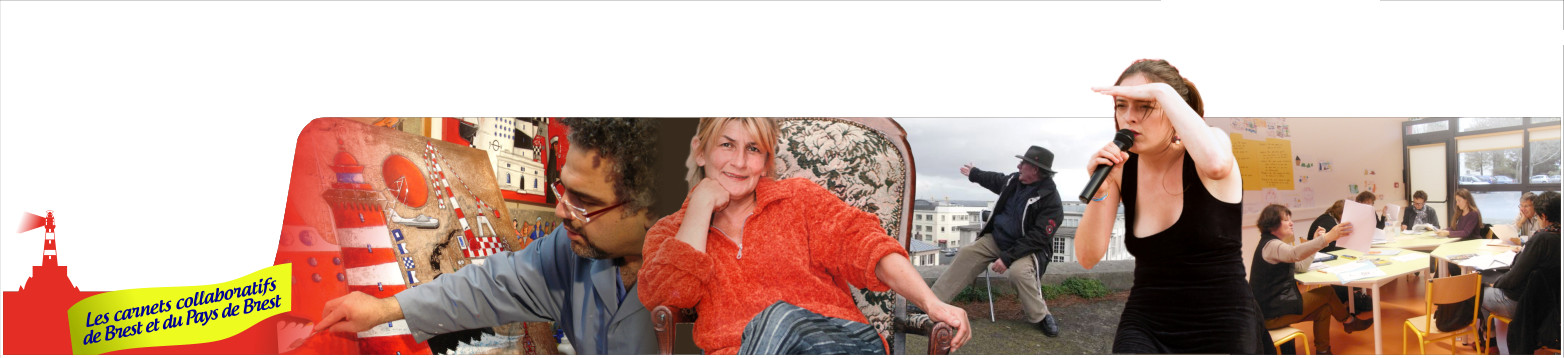Madame Cabasse, chef d'entreprise
Madame Cabasse
Entretien enregistré réalisé par Dorine Caroff le 17 mars 2009 à 16H00 à la mairie de Brest.
Élisabeth Cabasse a 79 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat à Paris à l'âge de 16 ans, elle entre à l'Université de la Sorbonne, en Licence de philosophie, psychologie et anglais. C'est à ce moment qu'elle rencontre son mari, Georges Cabasse. Il est alors dans une École Technique, passionné de musique, plus particulièrement de technique sonore. Il a pour ambition de créer des haut-parleurs avec une qualité sonore de haut niveau. Élisabeth le suivra dans son projet, montant avec lui leur première entreprise à Neuilly-sur-Marne. Puis ils se décentraliseront à Brest en 1960. Élisabeth Cabasse gérait tout ce qui était administratif, comptabilité, tandis que son mari s'occupait de la partie technique.
Pouvez-vous vous présenter?
Je m'appelle Élisabeth Cabasse. Je suis née à Paris, le 14 juillet 1929. Ma famille est à moitié tourangelle, à moitié parisienne. Maintenant toute la famille est bretonne. Mes études? Chaotiques pendant la guerre et l'occupation. On passait beaucoup de temps dans les abris, les queues, les pannes de courant et les déménagements. Même si on est protégé et insouciant entre 10 et 14 ans, on sent l'inquiétude autour de soi quand les nouvelles du front n'arrivent pas, quand on nous dit : « Nous allons chercher notre ami Frank à la gare, rappelez-vous qu'il s'appelle maintenant Marius. C'est angoissant quand une camarade d'école vous dit à la récréation : « C'est un secret, mais je te dis au revoir, je serais absente demain et je ne reviendrais plus ». J'ai ainsi appris qu'il y avait des juifs et des non juifs et pourquoi des amis des parents entassaient dans les communs des valises de leurs souvenirs, avant de partir « en vacances ». Quelques uns sont revenus, d'autres pas. Après la libération et deux ans de scolarité normale, j'ai eu mon bac un mois avant d'avoir 16 ans et il fallait une dispense! Je me suis illico inscrite à la Sorbonne à une Licence de philo/psycho et à une d'anglais.
J'ai la grande chance d'avoir eu des parents très ouverts : ils m'ont proposé de passer mes vacances en Angleterre chez des amis, comme tout se passait bien, décision a été prise que je rattraperai mes cours de fac en milieu de l'année et que j'irais à l'école du bourg. J'apprenais avec gourmandise, l'anglais, l'histoire vue d'en face, Shakespeare et le savoir-vivre vus de l'intérieur et le hockey... Juste après la guerre, personne de ma génération n'avait jamais quitté la France de son plein gré. Donc, à l'époque, faire des études à l'étranger, était impensable. J'ai continué ce panachage fac/voyages les années suivantes pour conforter cette magnifique expérience, qui dure toujours.
Donc, même la possibilité pour une fille de faire des études, ce n'était pas courant?
De mon temps si, c'était devenu courant, petit à petit. Du temps de ma mère, non et elle le regrettait : une fille ne voyageait pas seule. A son époque, dans bien des familles, une fille ne faisait que des études de culture générale et elle ne travaillait que si elle en avait besoin pour vivre, donc sans avoir eu le temps de faire les études qui donnent un métier. Les ouvrières, elles, en apprenaient un très jeunes, puisque la scolarité n'était obligatoire que jusqu'à 14 ans. En 1950, ce n'était plus du Zola, mais souvent encore, les conditions étaient difficiles. C'était plus souvent une obligation qu'une vocation. Elles pouvaient s'arrêter quand leur mari était monté en grade et ne plus travailler qu'à la maison était le rêve de beaucoup, même encore jeunes. Dans ma génération, nous avons eu plus facilement le choix : femme au foyer, carrière ou les deux en même temps. Nous nous moquions de Verlaine : s'il avait raison d'essayer de glorifier le travail au foyer, on voyait bien qu'il ignorait tout de ce qu'il appelait : « La vie de tous les jours aux travaux ennuyeux et faciles », dont le grand défaut n'était pas d'être ennuyeux, mais très souvent, imposé, dévalorisé et surtout pas aidé et pas partagé La preuve de ce dont elles étaient pourtant capables, je l'ai eue en voyant la transformation de la vie de ma mère pendant les cinq ans de guerre. Voilà son CV : professeur de cours de rattrapage quand les alertes nous cantonnaient à la maison ; agricultrice transformant les pelouses en potagers, les cours en poulailler, les recoins en cages à lapins ; couturière taillant des robes dans les rideaux et des dessus de chaussures à semelles de bois dans des smokings, luxe ridicule ; championne cycliste de la course au ravitaillement ; spécialiste du bricolage système D ; infirmière à l'hôpital ; etc... Après la guerre, elle est « rentrée dans le rang », normalement, sans secousse. Elle avait son brevet et son permis de conduire, c'était pourtant rare. Riche des initiatives qu'elle avait prise et réussies, elle aurait pu devenir plus libre. Elle s'est résignée, avec le sourire. Je veux croire que ce qui l'a sauvée, c'est la pensée d'avoir donnée à ses filles le droit à la liberté que, elle, n'avait fait que goûter.
Maintenant, une femme peut choisir la maison pour cadre d'activités. Elle a acquis les compétences informatiques, juridiques et autres et les outils modernes pour savoir gérer comme elle l'entend et y ajouter des bénévolats extérieurs valorisants. On aimerait pouvoir dire de toutes : elles ne triment plus, elles gèrent. Mais il semble impossible de porter un jugement global sur le travail des femmes- chaque cas est un cas.
En Licence à la Sorbonne, il y avait déjà beaucoup de filles?
Oui, beaucoup et aussi en agrégation. Pour une partie, il n'y a pas eu de suite, mais ces bases sont une aide à tout. Il y a eu des femmes aux carrières remarquables. Elles l'ont souvent payé cher...par contre il était courant d'être médecin, avocate, enseignante, commerçante, créatrice dans l'artisanat, journaliste, etc... Un bon début, mais pas de chefs d'entreprise dans l'industrie, sauf les femmes de tête qui reprenaient l'entreprise familiale quand leur mari mourait prématurément. C'était le cas d'une de mes grand-mères qui a géré pendant toute ma jeunesse l'entreprise et la famille, arbitrant tout avec lucidité et discrétion. Elle était à la fois un chef de tribu, une grand-mère attentive et une femme qui ouvrait des portes. Je ne saurai jamais assez dire tout ce que je lui dois. Elle présidait en outre une association : la Protection de la Jeune Fille, dont la gare de Montparnasse semblait être le noyau. Beaucoup de jeunes bretonnes y débarquaient sur la promesse d'un travail et auraient disparu sans cette mise en garde...
Vos études, si vous n'aviez pas rencontré votre mari, auraient débouché sur quelle profession?
Je voulais faire Sciences Po. Je pensais au journalisme. Je me disais : je vais voir Françoise Giroud, je lui dit : « Je voudrais travailler avec vous, je ne veux pas de salaire, vous me direz après ce que je vaux ». Elle était un modèle pour moi. La période héroïque des suffragettes était terminée. On pouvait être une femme avec les qualités et les défauts des hommes, être leur complément ou leur opposé, un pas vers l'égalité, dont elle disait je cite de mémoire : « L'égalité entre les hommes et les femmes sera atteinte quand on ne s'étonnera plus de voir nommer des femmes médiocres à des postes où l'on ne s'étonne pas de voir présider des hommes médiocres. »
C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, le droit des femmes?
Oui, depuis très longtemps. Nous étions trois filles et un garçon et nos parents étaient très libéraux pour l'époque, tout en étant extrêmement stricts sur les questions morales et sexuelles. Mon père, avant ma naissance, avait déjà écrit sur le droit de vote des femmes et aussi sur « Les États unis d'Europe ».
Quand vous avez rencontré votre mari, vous étiez encore à l'université?
Nous nous sommes rencontrés à l'Office du Tourisme Universitaire, sur le « Boul'Mich » pour un stage de travail agricolo/archéologique en Suède. J'ai fait l'expérience, lui a été appelé dans l'intervalle pour le service militaire. J'avais crié sur tous les toits que les garçons ne m'intéressaient que comme bons copains et que je ne ferai un mariage de raison qu'à 30 ans, âge canonique. Quand je me suis aperçue que je changeais d'avis, j'ai été vexée et heureuse. Quand mes parents ont su que nous voulions nous marier, ils ont été plus qu'inquiets : « Avec un inventeur tu mangeras de la vache enragée toute ta vie, avec vos deux fichus caractères ça ne durera pas deux ans ». Puis il m'a dit : « Réfléchis avant de faire la bêtise de ta vie. Va passer six mois chez mes amis à Vienne, ce sera au moins bon pour ton allemand qui est exécrable, (au collège nous faisions exprès de saboter les cours, c'était notre forme de résistance), et quand tu reviendras, tu feras ce que tu veux ».
Vienne est une ville que j'aime beaucoup. Après la guerre, la ville était découpée en quatre secteurs : anglais, français, russe, américain, des soldats traînaient partout. L'avortement avait dû être légalisé pour les victimes de viols. La fille de nos amis avait une camarade de notre âge qui portait une large cicatrice autour du cou, trace d'une corde. Elle avait été attachée à un arbre et violée. Je n'oublierai pas le choc que j'avais à chaque fois que je voyais son cou et je m'étonnais qu'elle puisse vivre normalement et rire.. Je croyais qu'on mourait de ces choses-là. J'avais 19 ans. Je me croyais adulte, mais n'avais pas le droit de sortir seule. J'étais confiée à une « duègne », une vielle dame hongroise charmante et très cultivée qui avait du fuir sans rien emporter quand son mari, un ministre important, avait été fusillé par les russes. Elle m'a beaucoup appris. De mon côté, j'ai commencé à essayer de détruire l'image que beaucoup d'étrangers avaient des françaises : Les Folies Bergères ou de jolies saintes Nitouches, pas de juste milieu... Quand je suis rentrée après 6 mois d'échanges, de lettres maculées des tampons des différentes censures, j'ai dit : je n'ai pas changé d'avis.
Comment êtes-vous devenue chef d'entreprise?
Un jour j'ai rencontré un garçon passionné de recherches sur le son. Il bricolait des haut-parleurs dans sa chambre au grand désespoir de sa mère. J'étais très raisonnable et je pensais amicalement faire une bonne action en le dissuadant de créer l'entreprise dont il rêvait : personne n'avait encore entendu le mot « hi-fi ». C'est lui qui finalement m'a embarqué dans l'aventure...
Votre mari faisait de la recherche?
Si on peut dire...En réalité, il n'en avait pas les moyens. A côté de la mer et des bateaux, il a deux passions : la musique et l'électronique. Il allait aux concerts salles Pleyel ou Gaveau. Quand il revenait écouter ses disques, il était désespéré de la qualité du son. Il essayait d'incroyables montages pour améliorer électronique et haut-parleurs, persuadé qu'on pouvait parvenir à une reproduction fidèle des sons...Le mot haute-fidélité n'existait pas. Nous avons été fous de joie quand il est apparu des années plus tard. J'ai été longue à comprendre où il voulait en venir. Un jour, alors qu'il me raccompagnait en métro, il m'a dit : « Les étudiants en philosophie sont drôles. Ils croient s'intéresser à tout, mais ne se posent pas les questions les plus simples sur ce qui se passe sur Terre. Par exemple, vous-êtes vous demandé comment la porte de ce wagon s'ouvre automatiquement? » Après, il m'a déclaré que la philo, je pouvais en faire toute seule et que je ferais mieux de prendre des cours de comptabilité et d'économie et de la dactylographie. J'ai compris que c'était une demande en mariage. A 21 ans, on s'est marié. A l'époque, la sténo-dactylo, c'était un travail de femmes, les hommes ne touchaient pas un clavier, sauf mon père. Il disait qu'il y avait le meilleur et le pire aux États-Unis, mais qu'au moins, les hommes n'ont pas honte de savoir utiliser un clavier. Je n'ai pas eu honte.
Comment êtes vous parvenus de ces premiers bidouillages à l'entreprise Cabasse? Dès le début, vous êtes vous investie dans ce projet?
Je me dis souvent que c'est un miracle. Ma famille était désespérée, mais dès que le sort en a été jeté, nous avons été soutenus, discrètement, sans en avoir l'air. J'ai quitté la fac, je m'étais dit : « C'est tout ou rien, de toute façon, il ne peut pas réussir , ou perdre, seul. » Nous avons commencé avec un apprenti. Nous avions loué un petit local, dans le nord de Paris, puis une petite maison de banlieue à Neuilly-sur-Marne, à côté de l'endroit où l'Abbé Pierre a débuté lui aussi en 1950. Par un heureux hasard, un lointain cousin a été nommé curé de la paroisse toute proche de Gagny. Il aidait ce prêtre inconnu et considéré comme visionnaire, à reclasser des égarés. Je lui ai dit : « Tu tombes bien, trouve nous un chef d'équipe. »L'équipe, c'était Michel, l'apprenti de Paris, il avait quitté pour la première fois le 19ème arrondissement pour continuer l'aventure avec nous. Je n'oublierai jamais l'homme choisi par l'Abbé Pierre. Il a été précieux. Il avait un beau nom : William-Gaêtan Caracolle.
Quel était votre rôle au sein de l'entreprise?
Nous étions et sommes toujours complémentaires : à Georges la recherche, la fabrication, les innovations, bref, il donnait le cap à suivre. Pour moi, les ressources humaines, la comptabilité, les litiges, bref l'intendance : tirer les bons bords pour tenir un cap qui changeait souvent. Du moins j'essayais.
C'est ce que vous avez fait tout au long de votre carrière?
Oui et non. Petit à petit, j'ai délégué à plus compétent que moi dans chaque domaine. Un chef d'entreprise doit déléguer. N'ayant ni expérience, ni formation, j'ai du inventer et faire confiance aux professionnels que j'embauchais. Je crois que l'on gagne plus à faire confiance, quitte à se tromper, qu'à décourager par de la méfiance ceux qui sont compétents et motivés. J'ai bien sûr fait des erreurs, mais l'équipe en grandissant est restée motivée et sympathique... Comme Monsieur Jourdain, j'ai fait du « management intuitif », sans le savoir... Cahin-caha, ça a marché, mais j'ai souvent regretté de ne pas avoir eu auparavant une vraie formation et un peu d'expérience ailleurs. Le plus enrichissant a été l'organisation des salons et expositions dans le monde entier : Chicago, Tokyo, Stockholm, Las Vegas, Barcelone, Milan, Prague, Zurich, Düsseldorf, Sydney, St Petersbourg, etc... J'aurais voulu savoir plus de langue. Je parlais anglais, je me débrouillais en allemand. Il m'est même arrivé de bredouiller en latin avec un russe.
Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous aviez un ouvrier et celui où vous avez voyagé?
Très peu. Le démarrage en France a été au bout de cinq ans : un ingénieur d'une société parisienne a fait irruption un jour en disant : « J'ai entendu dire qu'on fabriquait ici des haut-parleurs et même des veaux à cinq pattes si besoin. » Il s'agissait de la sonorisation du Rex, le plus grand cinéma de Paris à l'époque, qui allait projeter pour la première fois en Europe le premier film en Cinémascope avec un son sur cinq canaux. C'était un peplum, La Tunique. Nous avons travaillé jour et nuit pour faire du jamais fait. La presse a été très bonne. Personne n'a remarqué qu'au moment où Ben Hur lâche une flèche d'Est en Ouest, son sifflement a travers la salle en sens inverse.
A ce moment là, au début, quelle était la vision des employés du fait d'avoir une femme comme chef? Avez-vous eu des difficultés?
Non, ou je ne m'en suis pas aperçue. Les femmes, qui avaient 20 ans de plus que moi, participaient et étaient contentes de m'expliquer ce que je ne savais pas. Pour les ouvriers, une femme qui travaille, c'est normal, qu'elle soit chef ou non. Leurs femmes à eux travaillent et tiennent les cordons de la bourse le plus souvent. C'est souvent l'échelon intermédiaire, le petit chef, qui a des réticences inavouées. Je les connaissais bien. Mon père était industriel et à cette époque, l'usine, notre maison et quelques unes des leurs faisaient un îlot. J'étais cheftaine de louveteaux et leurs enfants se retrouvaient dans ma meute avec mon jeune frère et d'autres garçons de tous les horizons. Horizons que nous nous ouvrions mutuellement. Ce type de commandement, strict et joyeux me convient.
A l'atelier, j'entendais dire : « C'est Lisbeth qui a dit, t'as pas à discuter ». Mais devant moi, ils disaient Madame Élisabeth. Nous recevons quelques fois encore leur visite. Le fait d'être une femme m'a permis d'aborder un grave sujet, tabou et essentiel dans une entreprise où travaillaient beaucoup de femmes : l'avortement. De temps en temps, une femme venait à mon bureau, me demander, les yeux cernés, une avance de salaire. Je crois me rappeler que c'était 1000 francs, le tarif. Que pouvais-je faire? L'avortement était interdit, les moyens de contraception difficiles à se procurer et les interventions clandestines dangereuses. J'en avais eu la preuve à nos débuts et j'en ai été frappée à vie. Un matin, un vieil ouvrier tôlier est arrivé effondré : on venait de découvrir sa belle-fille morte. « Elle a été voir la femme qui fait ça avec une aiguille à tricoter et ça a raté. Elle n'a rien voulu nous dire et elle perdait son sang. Elle a perdu tout son sang. Elle est morte vidée comme un poulet, vidée comme un poulet madame. » Je n'oublierai jamais et chaque fois que je donnais un billet, je revoyais ce vieux monsieur ravagé et j'essayais de faire comprendre aux filles de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, mais j'avais l'impression de me mêler de ce dont elles voulaient garder le mystère et le risque. Une de nos délégués du personnel était une femme que j'estimais : dure, droite pas facile mais intelligente et claire. N'y tenant plus, en la croisant dans un couloir, je lui ai dit que je voulais depuis longtemps lui parler du sujet tabou et de l'ouverture du centre de planning familial à Brest, que personne ne connaissait, pas même les médecins. Nous sommes tombées d'accord, sans besoin d'en dire plus. Le sujet la taraudait elle aussi et elle ne savait comment aborder le sujet avec moi...Les débats furent laborieux : les femmes et surtout les filles ne voulaient être vues dans le Centre de Planning, elles ne voulaient pas de réunion dans l'entreprise, parce que les hommes se moqueraient d'elles : ils trouvaient ça gênant, honteux, pas propre- comme si c'était propre de se laisser mourir de ça... Finalement, tout s'est organisé et quand on venait me demander une avance ce n'était plus pour « ça ». Est-ce que la génération actuelle se rend compte de ce qu'elle doit à Simone Veil?
Vous aviez une majorité d'hommes ou de femmes?
Au bobinage et au montage des haut-parleurs, des femmes, à la mécanique, des hommes, moitié/moitié.
Pensez-vous que cela aurait posé plus de difficultés si vous aviez été seule?
Cela aurait été tout simplement impossible. Nous sommes complémentaires presque en tout, par exemple : dans le mode de management. Georges donne des ordres, comme si chaque chose était une évidence et il est quelque fois un peu cassant sans s'en rendre compte. De mon côté, j'essaye d'expliquer, même si je n'ai pas tout compris...Je suis nulle en électronique, informatique et physique, lui sait, et apprend d'instinct et pense que tout le monde est comme lui...
Vous étiez peut-être moins dure?
Ce n'est pas une question de dureté, il suffit de prendre le temps de se mettre à la place des gens avec qui vous travaillez. Les quelques rares problèmes de communication sont venus de l'extérieur : un contrôleur qui vous fait comprendre que si vous êtes gentille il ne s'apercevra pas que vous avez fait une erreur dans votre déclaration, un syndic qui pose sur vous un regard dégoulinant de limace...J'étais très jeune, nous étions encore à Neuilly-sur-Marne, mais on apprend vite à faire comprendre, sans vexer, qu'on s'est trompé de porte. Je n'ai jamais eu de représailles. Ils étaient bons joueurs. Il y a aussi de bonnes surprises : j'étais arrivée à mon premier contrôle fiscal avec mon grand registre de comptabilité manuscrite relié en noir. L'inspecteur m'a demandé quelle était notre activité. J'ai répondu que mon mari était inventeur. Il a refermé le registre en disant avec un sourire apitoyé : « Mon pauvre petit, bon courage ». Quand nous sommes partis pour Brest, il m'a conseillé de choisir une vraie comptable. J'ai répondu : « Oui, avec de la tête, du cœur et du cran ». Il a acquiescé. C'est ce que nous avons eu, pendant 40 ans.
Et avec les clients, cela se passait bien?
Très bien. A l'étranger, on était toujours content de voir une française. Pour certains, j'étais la première civile venant de France depuis la guerre.
Et la suite?
Nous commencions à exploser dans notre maison/atelier de banlieue. Ne pouvant nous agrandir, la seule solution était de nous décentraliser. Georges voulait la mer : j'ai fait des propositions à des dizaines de maires de Dunkerque à la Rochelle, pas plus au Sud. De Brest est arrivé un jour le chef de cabinet du jeune maire, Georges Lombard. Nouvellement élu, il venait de retrouver notre lettre dans un tiroir et nous proposait un champ entouré de talus, où nous avons été reçus par des vaches. C'était Kergonan. En 1960, personne ne savait que cette campagne deviendrait une zone industrielle. Pas de route, à peine des chemins. Nous étions les premiers. Brest s'arrêtait à la place de Strasbourg. Empreintes s'est installée peu après nous. Pas près de la mer, mais on savait qu'elle était là.
Les ouvriers de Paris, vous ont-ils suivis?
Nous avons organisé un voyage pour leur présenter le nouveau site. Les femmes ne pouvaient quitter leur mari, les hommes avaient peur d'aller si loin. La mairie, les écoles étaient encore baraques. Paris était à 12 heures de train. Un seul, un fidèle, a immédiatement embarqué, sa femme, sa fille, son chien et son déménagement. Il a été directeur de l'usine, jusqu'à sa retraite.
Donc il a fallu tout recommencer, trouver des ouvriers? Cela ne posait pas de difficultés que ce soit une femme qui fasse les embauches?
Non, je faisais les entretiens, quand ils me semblaient bons, les tests techniques étaient faits par les responsables des ateliers. Certains qui sont entrés comme apprentis à 14 ans, sont restés toute leur carrière. Je me souviens d'avoir été frappée de la qualité de leur bagage culturel : comme il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi, à part « sous l'état » à l'arsenal, garçons et filles faisaient des études plus longues. Contrairement à ceux de la banlieue parisienne, leur français était parfait et ils étaient très soignés.
Avez-vous subi des grèves?
Évidemment celles de 68. Le seul problème était que ceux qui faisaient le plus de bruit étaient des inconnus, venus d'ailleurs...
Comment avez-vous géré cette situation? C'est vous qui avez négocié?
Il n'y avait rien à négocier, puisque la grève ne concernait pas un litige spécifique à l'entreprise. C'était une grève générale, de solidarité et de besoin de changement et qui dépassait nos compétences. Mais j'ai compris la nécessité de ce défoulement quand, dans une recherche de date pour une réunion, une déléguée s'est trompée sur le jour où nous étions et s'est écrié avec joie : « C'est extraordinaire, on ne sait plus comment on vit ». Nous avons tous besoin de temps en temps, de crier ce que nous ne disons pas. La dérive est de déguiser en grève un besoin animal de démolir, ou de ne pas savoir s'arrêter à temps. Nous n'avons eu aucune dégradation. Le seul incident est dû à des inconnus qui faisaient un barrage pour empêcher les chefs d'équipe d'entrer dans l'usine pour mettre les sécurités. Un grand gars faisait des moulinettes avec une chaîne de bicyclette, pour nous empêcher de traverser la foule. Je me disais : « Il faut que je les fasse entrer, mais, quand je vais arriver à la chaîne tournoyante, qu'est ce qui va se passer? ». Il a baissé sa chaîne. Il y a une éthique : on ne cogne pas sur une femme.
Qu'a pensé votre entourage de cette réussite à laquelle ils ne croyaient pas au début?
Mes parents ont été extraordinaires de générosité lucide : nous laisser faire notre voltige sur le trapèze, mais être le filet salvateur, au cas où... Quand elle entendait à ma voix qu'il n'y avait plus un sou dans la caisse après la paye, ma mère me disait que cela lui ferait plaisir d'avoir les enfants quelques jours. Ils pouvaient alors manger comme quatre, bien qu'ils ne soient encore que deux. Je n'ai jamais dit que, quand j'arrivais chez la crémière et qu'elle criait avec satisfaction à son mari : « Elle me dit encore qu'elle a oublié son porte-monnaie, je lui donne quand même son lait? », je retenais à deux mains la claque qui me démangeait. Après, j'ai pris ça philosophiquement : elle avait une revanche à prendre. Nous avons appris plus tard que son mari avait été collaborateur, qu'on le lui avait fait payer en humiliations dont elle se vengeait... Mes sœurs avaient le tact d'acheter des robes « qui ne leur allaient pas ». Elles me demandaient de les en débarrasser pour leur rendre service! On sauvait la face avec humour et gaieté. Nous n'achetions rien pour nous. Tout pour l'atelier et les machines...
Combien avez-vous d'enfants?
Cinq. Cinq garçons.
Il a donc fallu que vous conciliez votre vie de chef d'entreprise, d'épouse et de mère, cela n'a pas été difficile?
Si, c'est difficile. On passe son temps à déterminer les priorités. On a l'impression d'avoir des yeux tout autour de la tête et de prendre une décision par minute : il est tard, est-ce que je termine ce dossier important, ou est-ce que je rentre voir comment évolue la rougeole du petit? J'ai dit un jour à Françoise Giroud, alors ministre de la culture, que je me servais tous les jours de la leçon de choix des priorités donnée dans un de ses livres. Elles étaient une mère, sa fille et elle suspectées par la Gestapo, et mises au cachot, quatre murs et un sol mouillé...Elles devaient passer un interrogatoire le lendemain. Françoise dit : « Si nous voulons ne pas perdre notre sang-froid demain, il faut avoir dormi » et elle étale son manteau par terre. La mère de la jeune fille horrifiée lui dit que son manteau va être gâché et que c'est irremplaçable. Elle et sa fille restent debout toute la nuit. Françoise et les deux manteaux des malheureuses ont été sauvés. Mais elles, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues.
Vous n'avez pas senti que vos enfants aient souffert de cette situation?
Ils me disaient que non, qu'ils ont appris à être autonomes très tôt et étaient contents de ne pas avoir toujours une mère sur le dos, mais ils disaient ça pour me faire plaisir... L'important est que le résultat pour eux soit bon, et nous sommes fiers d'eux. J'ai été aidée par des femmes remarquables qui faisaient partie de la famille. Les enfants disaient de l'une d'elle, qui est restée 20 ans avec nous, qu'elle était leur troisième grand-mère.
Vous avez eu besoin de cette aide là?
C'était vital puisque ma mère était à Paris et que mes horaires étaient plutôt 48 heures que 35 par semaine. Heureusement, aide familiale est maintenant un métier enseigné et estimé. Grâce à elles, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas que les femmes sans enfants qui peuvent avoir une profession. Nous sommes toutes solidaires.
A votre époque, il y avait peu de femmes chefs d'entreprise, même encore aujourd'hui?
Il y a quelques dizaines d'années, c'était une plaisanterie dans la profession que de dire que les réunions commençaient par : « Monsieur le président, Madame (j'étais la seule femme), Messieurs ». Maintenant il y a des femmes partout heureusement.
On a l'impression que c'est une différence entre les hommes et les femmes lorsqu'ils montent leur entreprise. La femme pense d'avantage à sa famille?
Il est évident, si mari et femme sont complémentaires, que chacun se spécialise. Pour moi, l'écueil à éviter, c'est d'avoir des chasses gardées, il faut des points communs et être interchangeables au besoin.
Vous aviez cette double position d'épouse et de chef d'entreprise?
Oui et cela a donné lieu à des scènes comiques. Par exemple, lorsque j'étais enceinte de notre troisième enfant, j'ai demandé à être salariée de l'entreprise et à bénéficier des allocations, etc...Le statut de conjoint n'existait pas et cela m'a été refusé. Je ne sais plus par quelle voie mon dossier est arrivé au Palais de Justice à Paris. Je n'étais jamais entrée dans ce noble bâtiment. Dans l'immense salle, les dossiers se suivaient, on somnolait. Arrive mon dossier et je comprend qu'il va aller à la poubelle. Je me suis levée, tremblante de trac et j'ai dit : « Si je comprends bien, si j'étais la maîtresse de mon patron et qu'il m'ait fait trois enfants, il n'y aurait pas de problème, mais nous avons commis l'erreur de passer devant Monsieur le maire! ». Tout le monde s'est réveillé. Quelques semaines ou mois après, je ne sais comment, mon dossier était accepté. Autre cadre : le Salon de la hi-fi à Tokyo. Il a fallu 10 fax pour faire admettre à l'hôtel que la personne qui serait avec Monsieur Cabasse dans la chambre double que l'on réservait était la légitime avec un vrai passeport et pas sa secrétaire. « On n'apporte pas sa bière quand on va en Allemagne » m'a dit Georges, « et pas sa femme si on va au Japon ».
Est-il plus difficile pour une femme que pour un homme de créer son entreprise?
Ce l'est de moins en moins : les mentalités changent, les travaux ménagers s'automatisent, les services à la personne soulagent les mères de famille, les moyens de communication aussi, etc...
L'éducation et les études que peuvent recevoir les filles jouent dans leur construction? Cela a-t-il été le cas pour vous?
C'est évident : heureusement que maintenant tout est accessible à tous, bien que l'égalité des chances ne soit pas parfaite, hélas. Si on mesure les immenses progrès faits depuis mon enfance, on ne peut pas imaginer que nos huit petites-filles et par ricochet nos deux petits-fils et notre arrière petite-fille n'en voient pas les fruits.
| |
Nous, créateur de cette œuvre ou ayant droit, n'autorisons aucune réutilisation de cette oeuvre sans notre autorisation, en dehors des exceptions permises par la législation française sur la propriété intellectuelle. |